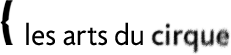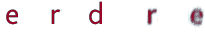par Pascal Jacob
« Qu’y a-t-il de plus semblable à un rêve que ces drames incohérents, impossibles, ambulatoires, où les hommes se changent en bêtes et les bêtes en homme ; où un monde bizarre se tord, fait la grimace, rampe, sautille, bat des entrechats, donne et reçoit des coups de pieds ; où les têtes se passent de corps, et réciproquement ; où les poissons se promènent en chaise à porteurs dans un paysage rose ? »
Théophile Gautier, L’Art dramatique en France, Paris, 1853
Bêtes de scènes
L’animal sur scène brise l’unité d’un lieu de convention. Sa présence, quintessence de vérité, remet brutalement en question la trame d’un univers où tout est feint. L’animal crée l’imprévisibilité des actions, oblige ceux qui l’entourent à prendre en charge l’événement qu’il induit, il contraint les acteurs à l’acceptation du hasard, à être prêts à tout, ou presque.
Sur la piste en revanche, l’animal est sur un terrain conquis depuis longtemps et c’est là que la notion d’évolution est cruciale, que la notion de dressage notamment doit désormais être réévaluée à l’aune de la création, de la dramaturgie et de la justesse.
L’une des mutations les plus significatives en la matière est ce glissement progressif de sens et d’intention d’un exotisme forcené au profit d’une nouvelle complicité avec les témoins de notre quotidien. Une simplicité qui n’exclut ni le charme ni la curiosité, mais qui place l’animal dans une nouvelle dimension. En réalité, la fascination pour le vivant est intacte, mais elle s’enrichit d’une approche plus contemplative et infiniment moins exigeante en matière de prouesse, de performance ou de prise de risque. L’animal savant détient aujourd’hui un « vrai » rôle à jouer, une intéressante contradiction quand sa seule présence suffit même parfois à justifier son intrusion sur la piste.
Cette idée d’une créature vivante, aux réactions aléatoires, simplement posée dans un espace déterminé, renvoie autant aux mécanismes de présentation du cabinet de curiosité qu’à ceux de la ménagerie, mais l’existence de ces nouveaux acteurs est potentiellement drapée d’intelligence et n’a plus grand chose à voir avec le fonctionnement d’une pure exhibition. En revanche, ces bêtes de scène n’ont rien perdu de leur capacité à mobiliser l’attention des spectateurs. Leur apparente banalité est un atout paradoxal : inoffensives et proches du public, elles constituent un élément de vocabulaire scénique d’une redoutable efficacité.
Jeux de scène
En 1982, André Engel et son décorateur Nicky Rieti noient la salle du Théâtre National de Chaillot dans la brume et recouvrent les sièges de tissu blanc pour y présenter Penthésilée d’Heinrich von Kleist (création 1808). Aux côtés des comédiens, le metteur en scène place des chiens samoyèdes, aussi blancs que le décor, témoins du drame au même titre que les spectateurs et celles et ceux qui le jouent. Avec L’Orgueilleuse, Marie Molliens s’appuie à son tour sur le texte du dramaturge allemand et convoque des acrobates, des musiciens et des lévriers barzoïs pour une interprétation métaphorique du drame romantique et une mise en abyme de la figure de Penthésilée, reine des amazones et guerrière farouche dont une mise en œuvre des vertiges circassiens à fins d’illustration s’accommode très bien.
Ce « dressage » en creux suggère une strate supplémentaire dans la pyramide des possibles. La ductilité syntaxique de ces bêtes est comparable à la justification de la présence sur scène de poules et de moutons pour le spectacle In Vitro de la compagnie Archaos. Ces animaux « immobiles » s’inscrivent dans une filiation ancienne, mais suggèrent également que l’animal est capable de prendre la tangente sans perdre pour autant sa légitimité d’acteur (in)conscient aux côtés, sinon sur l’épaule, de comédiens inquiets.
Présences
Au début des années 1990, la Volière Dromesko impose une autre acceptation de la présence muette d’animaux vivants dans un contexte spectaculaire. En créant un espace scénique inédit doté d’une coupole translucide, en y installant un arbre aux branches multiples et en y lâchant deux cents oiseaux accompagnés par un cheval ailé et quelques rats. Dernier chant avant l’envol et Vertiges sont des propositions fondées sur l’échange et le partage, un rapport différent au minuscule et au sans apprêt, une immersion du spectateur au quotidien des oiseaux. Ces bêtes, du cheval au corbeau, établissent un nouveau nuancier du désir d’animalité dans un contexte qui s’en est longtemps tenu à la plus stricte orthodoxie en la matière, en matérialisant depuis le XVIIIe siècle une relation fondée sur un mélange de complicité et de domination. En 1991, le Cirque Plume offre avec No Animo mas Anima un magnifique prétexte à Cyril Casmèze pour abolir encore un peu plus les frontières entre l’homme et l’animal. En créant la silhouette de « l’homme-chien », il franchit de nouvelles bornes déjà rendues poreuses par une poignée d’illustres devanciers accomplissant reptations et sauts dans des costumes cousus comme de secondes peaux. Nu, ou presque, « dompté » par une partenaire capable de faire claquer son fouet avec autant de force et de précision qu’une « vraie » dompteuse, l’acrobate n’a que son corps et sa gestuelle pour seuls artifices. Cyril Casmèze n’a « que » ses muscles conjugués à une extraordinaire « souplesse animale » pour faire oublier qu’il est un homme, mais sa composition est remarquable, plus vraie que nature, et sa justesse est confondante.
Vingt-cinq ans après la fondation du Théâtre Dromesko, creusant un sillon esquissé à l’aube des années 1990, Igor et Lily intègrent des animaux vivants dans chacune de leurs créations. Ils y cultivent une forme d’instabilité théâtrale inhérente à leur désir de jeux. Le Jour du grand jour insère dans une trame à la fois grave et légère plusieurs animaux au statut établi de complices : un poney, un cochon et un marabout assument la part d’animalité dans une représentation où les séquences s’imbriquent comme un puzzle intuitif, plein de sensibilité et d’humour. Les chiens complices du Cirque Aïtal, fondé par Kati Pikkarainen et Victor Cathala, dans Pour le meilleur et pour le pire, 2012, comme le facétieux Zippo dressé par Jacques Marquès pour Toiles au Cirque Plume en 1993, sont là pour décaler une perception du dressage longtemps considérée comme un habitus culturel aux règles intangibles.
Comme un contrepoint élégant à ces variations, la compagnie Baro d’Evel crée en 2015 Bestias, un spectacle où galopent les chevaux et volent d’insolites petits oiseaux, corbeau, pie et perruches, plus apprivoisés que dressés par Tristan Plot, oiseleur : les animaux sont associés aux hommes et formalisent une nouvelle approche de la proximité comparable à celle des lévriers barzoïs de L’Orgueilleuse mise en scène par Marie Molliens au cirque-théâtre Rasposo.
Le désir d’animalité, de complicité est toujours aussi fort, pourtant le statut d’animal prétexte, à l’image de cet âne volant dans Le château des Lutins en 1718, a considérablement évolué depuis le XVIIIe siècle. Lorsque le dramaturge letton Alvis Hermanis met en scène et crée les décors de La Damnation de Faust à l’Opéra Bastille en 2015, il place pour les besoins de son approche dramaturgique un bœuf vivant dans une cage de verre. Les temps ont changé : l’opinion publique s’émeut et la bête crée une polémique jusqu’à son retrait pour les représentations suivantes. Une victoire pour certains, la preuve surtout que l’animal, au sens strict du terme, a toujours autant d’impact dans l’édification d’un imaginaire collectif et que sa manipulation, délicate et conscientisée, a encore de beaux jours devant elle.