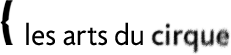par Sophie Basch
Le roman du cirque est avant tout le roman du clown. Son succès coïncide avec les années où Paris s’impose comme la capitale du cirque, entre 1870 et 1914.
L’impossibilité d’assigner un sens historique au temps se dégage de l’intérêt porté, après la Révolution, aux manifestations insolites. En littérature comme en peinture et en musique, l’attention privilégie les exclus, les marginaux, les pitres, jetés sur le devant de la scène par l’esthétique du grotesque, nouveau principe régissant « le génie de la mélancolie et de la méditation, le démon de l’analyse et de la controverse1 », propres aux temps modernes.
Théoricien du romantisme, Hugo crée les figures monstrueuses de Quasimodo et de Gwynplaine, « l’homme qui rit », le clown défiguré dès l’enfance. Du Fantasio de Musset au Nain de Zemlinsky en passant par le Rigoletto de Verdi, le Paillasse de Leoncavallo et le Pierrot de Schoenberg, les silhouettes grimaçantes, difformes et fantasques traversent la dramaturgie.
Le triomphe du bizarre peuple l’univers romantique d’étranges créatures, macabres ou triviales. Charles Nodier invente l’« école frénétique », Baudelaire l’« école satanique », dans les années où les cirques, abritant monstres et prodiges, s’imposent comme de nouveaux temples. Dès 1831, dans Barnave , Jules Janin affirme que le cirque, avec son « vrai sang », ses « vraies larmes », est supérieur au théâtre. En 1859, les Goncourt trouvent au cirque « les seuls talents au monde qui soient incontestables, absolus comme des mathématiques ou plutôt comme un saut périlleux2 » : en 1879, le roman d’Edmond, Les Frères Zemganno , les immortalise. Le cirque renoue avec l’origine sacrée de la tragédie et ressuscite les mystères médiévaux. Sous les chapiteaux, l’homme moderne quête une nouvelle transcendance, disparue des coupoles et des nefs sécularisées. Joris-Karl Huysmans voit dans les cirques « le chef-d’œuvre de la nouvelle architecture » : « là, dans une prodigieuse altitude de cathédrale, des colonnes de fonte fusent avec une hardiesse sans pareille. L’élancé des minces piliers de pierre si admirés dans certaines des vieilles basiliques semble timide et mastoc près du jet de ces légères tiges qui se dressent jusqu’aux arcs gigantesques de ce plafond tournant, reliés par d’extraordinaires lacis de fer, partant de tous les côtés, barrant, croisant, enchevêtrant leurs formidables poutres […]3 ». Octave Mirbeau compare la décoration du Cirque d’Été, avec « ses émaux champlevés sertis de gemmes, châsses mosaïquées, orfèvreries, étoffes lourdes et lamées », à « toute la desserte riche d’une abbaye morte4 ».
En décrivant le « Pierrot anglais », en 1855 dans De l’essence du rire , avec son teint blafard et ses taches rouges de phtisique, Baudelaire définit le clown français, dont le modèle s’impose à ses compatriotes puis au monde entier. L’ombre du clown s’étend et envahit le paysage littéraire. Jules Laforgue imagine un Hamlet clownesque. Stéphane Mallarmé loue « les frères Dorst, ces clowns, non, ces convulsionnaires, non, ces danseurs d’un quadrille étrange, appelé d’un nom calme et exaspéré : les Frétillants5 ». Les Pierrots déments qu’Henri Rivière et Jean Richepin représentent dans leurs romans Pierrot (1860) et Braves gens (1886), confirment la transformation de l’aimable rêveur lunaire en inquiétant lunatique. Cette évolution était déjà annoncée en 1833 par Théophile Gautier : avant de sombrer dans la folie, le peintre Onophrius avait reconnu dans la lune « la figure blême et allongée de son ami intime Jean-Gaspard Deburau, le grand Paillasse des Funambules6 » (![]() lire l'extrait ). Coqueluche des écrivains et des artistes, les sinistres clowns irlandais Hanlon Lee , Pierrots en habit noir, accentuent l’angoisse dégagée par « l’Homme blanc7 ». Leur succès aux Folies Bergère, dans les années 1870, coïncide avec les débuts d’un médecin, bateleur dans d’autres amphithéâtres. Percevant l’histrionisme de ces séances publiques, Joséphin Péladan écrit : « les gens de théâtre sont des Charcot8 » (
lire l'extrait ). Coqueluche des écrivains et des artistes, les sinistres clowns irlandais Hanlon Lee , Pierrots en habit noir, accentuent l’angoisse dégagée par « l’Homme blanc7 ». Leur succès aux Folies Bergère, dans les années 1870, coïncide avec les débuts d’un médecin, bateleur dans d’autres amphithéâtres. Percevant l’histrionisme de ces séances publiques, Joséphin Péladan écrit : « les gens de théâtre sont des Charcot8 » (![]() lire l'extrait ), annonçant des propos polémiques sur le monde littéraire contemporain, une « Salpêtrière de la littérature », qui contient « de quoi étonner tous les matins les Charcot de la critique, ces charlatans ahuris ». Le pamphlétaire conclut : « Je souris des clowns de l’hystérie ».
lire l'extrait ), annonçant des propos polémiques sur le monde littéraire contemporain, une « Salpêtrière de la littérature », qui contient « de quoi étonner tous les matins les Charcot de la critique, ces charlatans ahuris ». Le pamphlétaire conclut : « Je souris des clowns de l’hystérie ».
Dans le dernier tiers du XIXe siècle, les Pierrots d’Adolphe Willette, étendards de l’époque et doubles d’un peintre attaché à l’esprit français jusque dans ses égarements les plus funestes (ce « fils de la Lune » est un redoutable antisémite), confirment la christianisation du clown. Pour le cabaret du Chat Noir, Willette compose un gigantesque charivari funèbre, un cortège de Pierrots au Calvaire : Parce Domine. Brodant sur Au clair de la lune, la célèbre contredanse attribuée de façon erronée à Lully, Willette multiplie les scènes de mortification comique, les Pierrot pendu, le Pierrot au Père Lachaise intitulé De Profundis.
La dérision envahit alors le paysage littéraire, artistique et musical. Ravel compose sa Sérénade grotesque en 1893, pour se moquer des musiciens contemporains (il écrit La Parade en 1896, devançant Satie de vingt ans), et dédie au clown espagnol l’Alborada del gracioso en 1904 – Picasso est proche, qui réalise en 1905 une célèbre étude de saltimbanques inspirée par la pièce de Santiago Rusiñol, La alegria que pasa. Toulouse-Lautrec, qui passe une partie de sa vie au cirque, se fait photographier en clown contrefait. Le salut du nain passe par le cirque, Marcel Aymé l’a bien compris qui fait grandir celui du cirque Barnaboum (Le Nain, 1934), comme plus récemment John Irving qui, dans Un Enfant de la Balle (Son of the Circus, 1994), plonge dans l’univers rédempteur du cirque indien, avec ses clowns nains et ses petites prostituées rachetées par le trapèze : « Il n’y aurait jamais assez de cirques pour tous les enfants que le jésuite croyait pouvoir sauver ». Dans un beau livre illustré pour la jeunesse, Fred Bernard et François Roca donneront le nom du Sauveur à un homme-tronc, gloire du chapiteau (Jésus Betz, 2001).
![]() écouter un extrait de l’Alborada del gracioso de Ravel, interprété par la Nouvelle Association Symphonique de Paris dirigée par René Leibowitz, en 1954
écouter un extrait de l’Alborada del gracioso de Ravel, interprété par la Nouvelle Association Symphonique de Paris dirigée par René Leibowitz, en 1954
En 1917, dans ses Remarques sur le clown, André Suarès se sert du pitre pour distinguer la dérision de la caricature, qui s’applique aux objets médiocres et aux êtres bas : « Dans Jésus sur la croix, le clown, s’il osait, voit aussitôt le pantin de la divinité qui va pourrir, s’émietter au vent et danser la gigue. […] On peut faire la parodie du divin : on n’en fait pas la caricature, sans en dissiper la qualité divine, comme on noie une goutte d’ambre dans un plein tonneau de lessive ».
En 1928, le dramaturge belge Michel de Ghelderode publie La Transfiguration dans le cirque Escurial. À vingt ans de là, Henry Miller, l’ami de Rouault, de Max Jacob, de Chagall et de Léger, voit dans le clown « le poète en action. Il est l’histoire qu’il joue. Et c’est toujours la même sempiternelle histoire : adoration, dévouement, crucifixion » (The Smile at the Foot of the Ladder, 1948). Plus tard, Angela Carter, ne doutant pas que les clowns soient les fils des hommes comme Jésus celui de Dieu, évoquera la « tumultueuse résurrection du clown » éjecté de son cercueil de cirque, et retrouvera dans ce mercenaire du rire « l’image même du Christ », encadrée par toute la troupe du cirque, composée de saints : « Catherine jonglant avec sa roue. Saint Laurent sur son grill, un spectacle de phénomènes. Saint Sébastien, le meilleur lanceur de couteaux que vous ayez jamais vu ! Et Saint Jérôme et son lion savant la patte sur le livre, un grand numéro d’animal, qui enfonce la putain noire et son piano » (Nights at the Circus, 1984). En littérature, le XXe siècle n’a pas renié la leçon du XIXe.
![]() écouter des extraits de The Smile at the Foot of the Ladder, lus par Henry Miller en 1962
écouter des extraits de The Smile at the Foot of the Ladder, lus par Henry Miller en 1962
1. Victor Hugo, préface de Cromwell, 1828.
![]() lire l'édition originale sur Gallica
lire l'édition originale sur Gallica
2. Jules et Edmond de Goncourt, Journal. Mémoires de la vie littéraire, Robert Laffont, « Bouquins », 1989, t. II, p. 491.
![]() lire l'édition originale sur Gallica
lire l'édition originale sur Gallica
3. J.-K. Huysmans, « Le Salon officiel de 1881 » dans L’Art moderne, UGE, 1975, p. 198-199.
![]() lire le texte sur Gallica
lire le texte sur Gallica
4. Octave Mirbeau, L’Écuyère [1882], dans Œuvre romanesque, Paris, Buchet-Chastel, 2000, t. I, p. 787.
![]() lire le texte sur le site des éditions du Boucher
lire le texte sur le site des éditions du Boucher
5. Stéphane Mallarmé, dans La Dernière Mode, quatrième livraison, 18 octobre 1874, p. 8.
6. Théophile Gautier, Les Jeunes France [1833], dans Œuvres, Robert Laffont, « Bouquins », 1995, p. 57.
![]() lire l'édition originale sur Gallica
lire l'édition originale sur Gallica
7. Notion déclinée du terme anglais « White face », présent chez les poètes symbolistes fin de siècle tel Albert Giraud, alias Emile Albert Kayenberg (1860-1929) ; Pierrot Lunaire : Rondels bergamasques (1884), Pierrot Narcisse songe d’hiver, comédie fiabesque (1887) et Héros et pierrots (1898), mis en musique par Arnold Shönberg, création 1912.
8. Joséphin Péladan, La Décadence latine, éthopée, VI : la Victoire du mari, Paris, Dentu, 1889, p. 27.
![]() lire le texte sur Gallica
lire le texte sur Gallica